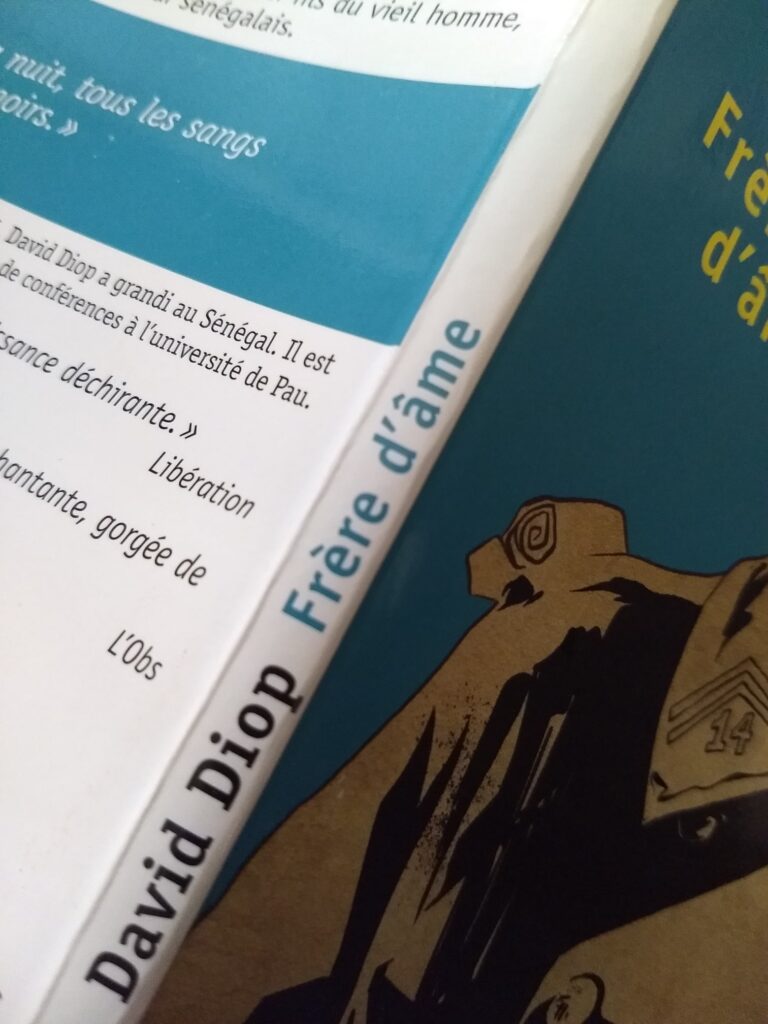
Frère d’âme de David Diop conte la guerre 14-18 vu par le regard d’un tirailleur sénégalais. L’extrait suivant le met en scène convoqué par ses supérieurs, lesquels ne parlent pas la même langue, ce qui lui inspire alors cette petite réflexion.
Traduire, ce n’est jamais simple. Traduire, c’est trahir sur les bords, c’est maquignonner, c’est marchander une phrase pour une autre. Traduire, c’est une des seules activités humaines où l’on est obligé de mentir sur les détails pour rapporter le vrai en gros. Traduire, c’est prendre le risque de comprendre mieux que les autres que la vérité de la parole n’est pas une mais double, voire triple, voire quadruple ou quintuple. Traduire, c’est s’éloigner de la vérité de Dieu, qui, comme chacun sait ou croit le savoir, est une.
« Qu’a-t-il dit? se demandèrent-ils tous. Cela ne ressemble pas à la réponse attendue. La réponse attendue ne devrait pas dépasser deux mots, voire trois tout au plus. Tout le monde a un nom et un prénom, voire deux prénoms tout au plus. » Le traducteur sembla hésiter intimidé par l’envol de regards sévères, barrés de soucis et de colère, s’abattant sur lui. Il se racla la gorge et répondit aux grands uniformes d’une petite voix presque inaudible : « je lui avais dit qu’il était en même temps la mort et la vie. »
Comme dans de nombreux conflits internationaux, plusieurs langues sont en jeu et la traduction (l’interprétation ici) se fait essentielle. Ainsi le montre d’ailleurs Séverine Autesserre dans un tout autre registre (dans son essai The Frontlines of peace), et pour le pendant de la guerre – le maintien de la paix. Elle y confie en effet que bien des émissaires de paix dans ces interventions ne parlent pas la langue de la zone de conflit dans laquelle ils ou elles exercent, menant alors à d’irrémédiables malentendus, voire de drames humains. Comme quoi, bien traduire/interpréter (et pas seulement dans les langues majoritaires) est parfois tout simplement vital.
1 commentaire