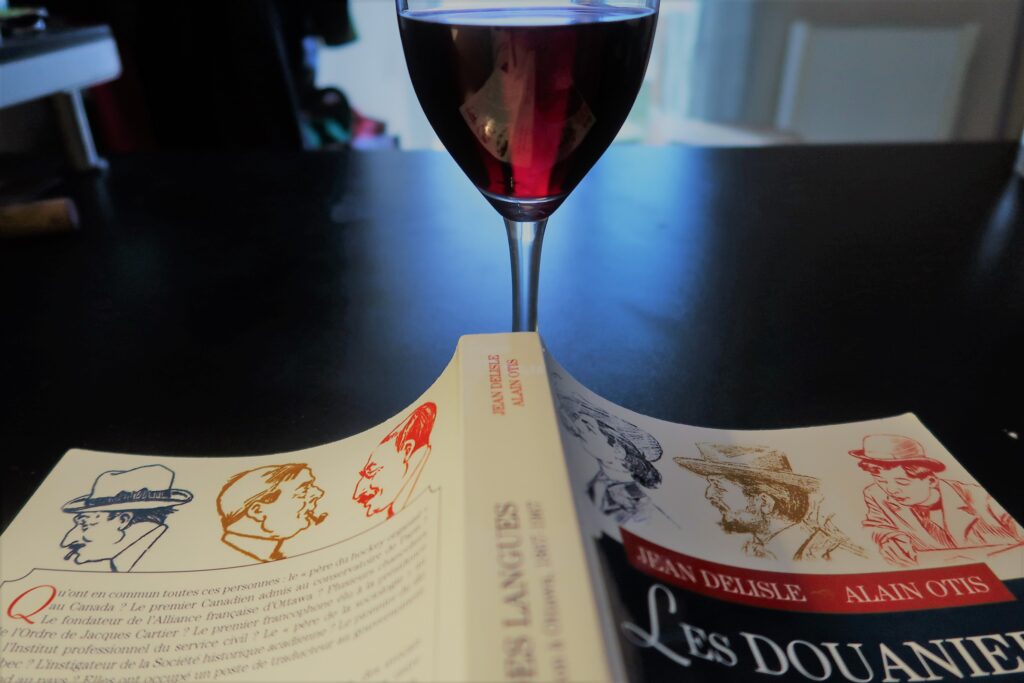
D’où vient Termium Plus, une des banques de terminologie à la réputation internationale? Grâce à qui pouvons-nous suivre des études en traduction à l’Université Laval, à l’Université de Montréal ou à celle d’Ottawa? Quand a été créé le Bureau de la traduction canadien, si souvent décrié (« ah, cette fiche termino qui date de l’an 40! », « oh, mais ça sent donc bien la traduction, ce texte… »)? Autant de questions auxquelles répond l’ouvrage de Jean Delisle et Alain Otis, qui s’attache à décrire, en dix-huit chapitres thématiques, une période clé pour la traduction au Canada : de 1867, date de son enchâssement dans la constitution jusqu’à 1967, juste avant son âge d’or.
L’histoire est dans les détails
Les douaniers des langues : Grandeur et misère de la traduction à Ottawa (1867-1967), c’est cela : l’histoire peu connue des débuts de l’industrie de la traduction au Canada, non seulement dans les grandes lignes (la Loi Parent en 1841, premier texte de loi à mentionner la traduction; la création du Bureau des Traductions en 1934, les premiers cursus universitaires de traduction dans les années 1950, l’arrivée de l’interprétation simultanée au Sénat en 1961…) mais aussi dans les petites, ne lésinant pas sur d’importants détails (constitution des équipes de traduction, formation, salaire, outils à disposition, etc.).
Sans omettre, par ailleurs, de délicieuses précisions dans une langue châtiée et savoureusement colorée qui donnent toute la substantifique moelle à ce passé qui, dans les livres d’histoires, est bien souvent confiné aux dates et aux « grands événements »!
« Malgré leur horaire chargé, les interprètes parlementaires trouvent parfois le temps, pendant la pause du midi, d’aller faire saucette dans la rivière des Outaouais, à un jet de pierre du Parlement. » (p.342)
Ainsi est brossé un portrait vivant de ces hommes et de ces femmes – les traductaires fédéraux d’Ottawa – qui ont bâti la traduction comme institution au Canada; au travers d’extraits de dialogues, de citations, d’anecdotes de déconvenues, d’échauffourées ou de comportements farfelus ou même des photos d’époque (oh cette photo des membres de l’Ordre de Jacques Cartier, avec en son centre M. l’abbé François-Xavier Barrette, énorme cigare au point!).
« L’interprète devait littéralement courir d’une cabine à l’autre chaque fois que l’orateur changeait de langue. » (p.349)
Réfléchir sur le bilinguisme d’État
Ce livre sera du reste précieux à toute personne qui souhaite, au-delà de ça, réfléchir aux questions de traduction et domination. Il n’est en effet un secret pour personne que le succès de ce bilinguisme institutionnalisé dans « la courtepointe multiethnique[1] » qu’est le Canada, est constamment remis en cause. En témoignent juste récemment les données de Statistiques Canada qui ont fait la une au pays : « Le français poursuit son déclin au Québec comme au Canada » titrait Le Devoir le 18 août 2022, « PM Justin Trudeau says decline of French in Canada ‘extremely troubling’ » lit-on du côté de la presse anglophone au même moment (Global News). Il faut dire que la traduction vient dans le contexte canadien s’insérer dans une lutte de cultures : au XIXe siècle, les catholiques francophones doivent batailler pour garder pied parmi les protestants anglophones. Et la traduction aura un rôle clé dans cette bataille, devenant un des instruments de l’égalité des langues au Canada, mais qui reste aujourd’hui un des problèmes de ce « bilinguisme de façade », une dualité linguistique asymétrique. Il serait intéressant ici de comparer avec d’autres pays officiellement bi ou multilingues tels que la Belgique ou la Suisse, également terres de traductions. Et de penser à l’avenir du bilinguisme canadien, à l’aune de la reconnaissance des langues autochtones en présence.
En parlant de Pierre Daviault et de son discours sur la dégradation de la langue française (p.281) : « Il aurait prôné l’athéisme dans un concile œcuménique au Vatican qu’il n’aurait pas suscité autant d’émoi »!
La traduction, indissociable de l’histoire canadienne
Il n’en reste pas moins que les traducteurs et les traductrices fédéraux des siècles derniers ont été au Canada instrument de la sauvegarde du français (et, soit dit en passant, grands pourvoyeurs d’emplois en traduction!). Ces « fins littérateurs », ces « passeurs », ces « douaniers » de la langue ont en effet permis petit à petit une certaine entente entre anglophones et francophones. Le livre montre ainsi, sans tomber dans la caricature et l’encensement, que la traduction est un moyen de créer des ponts entre cultures, comme elle l’est très certainement aux Nations Unies ou encore dans les institutions européennes, deux instances où la traduction joue un rôle majeur. S’il ne s’agit donc pas ici de faire l’éloge de la traduction à proprement parler, comme il en était question dans les ouvrages de Lori Saint-Martin ou de Souleymane Bachir Diagne, l’angle de l’histoire nous offre toutefois un bel hommage à ces personnalités bien peu connues du grand public (or, quelle contribution à l’histoire canadienne!).
« Sans les traducteurs, ces passeurs de sens, la littérature universelle ne saurait exister et voyager, chaque œuvre restant prisonnière de sa langue. » (p.373)
De la nourriture pratique pour le traductaire d’aujourd’hui
S’ouvrant fort à propos sur une question de traduction (dominion ou Puissance?), l’ouvrage plaira enfin à tout traductaire d’aujourd’hui qui s’intéresse aux tenants et aux aboutissants de sa profession, abordant – certes par petites touches – des questions très pratiques : l’importance de se spécialiser, les changements dans la profession avec l’arrivée de nouvelles technologies, de possibles méthodes de formation (la révision par les pairs, l’écriture…). On y trouve aussi des modèles « rassurants » : le parcours de ces traducteurs et traductrices est multiple; beaucoup n’ont pas que la traduction comme seule activité, certains ont plusieurs langues à leur actif, d’autres ont fait leurs études à l’étranger… et beaucoup ne semblent pas supporter la critique, un des premiers savoir-être vérifiés en entretien d’embauche de nos jours[2]!
Enfin est-il intéressant de constater comme la profession, essentiellement masculine à ses débuts (alors qu’essentiellement féminine aujourd’hui), se féminise très lentement : c’est par des postes « anodins » de sténographe ou commis que s’y font peu à peu une place les femmes qui, à l’époque, n’avaient de valeur qu’au fourneau une cuillère à la main. L’ouvrage parle peu de cette transition puisqu’il n’évoque qu’une période clé déterminée, trop en avant pour faire montre de ces changements. Le prochain ouvrage au programme de cette chronique sera donc l’occasion d’en toucher quelques mots!
« L’art de bien traduire s’acquiert par l’étude réfléchie des langues et des techniques de traduction jumelée à une pratique constante de l’écriture » (p.303)
***
Les douaniers des langues : Grandeur et misère de la traduction à Ottawa (1867-1967) de Jean Delisle et Alain Otis, paru en 2016 aux Presses de l’université Laval.
Voir aussi la critique de Jean-Nicolas de Surmont dans Cap-aux-Diamants, la revue d’histoire du Québec.
[1] Les douaniers des langues, p.425.
[2] « La phobie de la révision déclenche d’étranges réactions chez certains traducteurs. », ibid, p. 273.
1 commentaire